Conversation avec Emmanuel Guibert

Emmanuel Guibert
par Nicolas Guérin (2010)
Formation
Quelles sont vos origines ?
Je suis né à Paris en 1964 dans un milieu bourgeois aisé…
extrêmement agréable à vivre : j’ai des souvenirs
merveilleux de mon enfance ; je vis avec en permanence et je pense qu’une
grande partie de ce que je fais est conditionné par l’enthousiasme
que m’a insufflé mon enfance, cette idée que la vie
est quelque chose qui se célèbre. Dès qu’on
a ressenti qu’il y avait des grandes capacités de joie dans
l’existence, on se sent désireux de transcrire noir sur blanc
les raisons d’aimer être là. A près de quarante
ans, je me dis que je dispose de trois bonnes façons d’y
arriver. D’abord, faire rigoler les gens, et singulièrement
les petits, pour retrouver la source de mon amour de la bande dessinée
et restituer aux enfants ce que j’ai moi-même ressenti en
lissant les bandes que j’adorais. Ensuite, tenter de capter la vie
par le biais du témoignage. Enfin la collaboration avec des copains
avec qui je m’entends très bien et qui en même temps
sont très différents de moi et m’emmèneront
donc là où je ne serais pas allé seul. Une quatrième
piste serait une écriture de fictions qui se bousculent dans ma
tête sans trouver le moyen de s’échapper et qui se
résument pour le moment à des prises de notes à n’en
plus finir, toutes sortes de rêveries, sans déboucher sur
des scénarios, parce que je suis une limace qui mène une
vie très lente…
 Quelles
furent vos lectures d’enfance ?
Quelles
furent vos lectures d’enfance ?
Il y avait beaucoup de livres à la maison. Peu de bandes dessinées,
mais il restait chez ma grand-mère celles que mon père avait
lues petit, des Spirou de 1947-48, avec les premiers Lucky
Luke, les fameuses biographies de Jijé qui m’ont beaucoup
marqué… Sinon, j’ai lu tous ce que peuvent lire les
enfants amateurs de bandes dessinées que l’on ne restreint
pas dans cette passion : Tintin, Spirou, Pif, journaux auxquels
on était abonné à l’époque. Souvenirs
merveilleux, qui me font aussi reconnaître une qualité de
magistère à la bande dessinée : le nombre de choses
de l’existence que j’ai apprises par elle est considérable.
Par exemple, Goscinny a caressé mon intelligence dans le sens du
poil. Il m’a mis dans des états d’excitation du simple
fait que je me donnais l’impression de comprendre ce qu’il
me disait ou, de façon encore plus perfide, de ne pas comprendre
ce qu’il disait. Tout cela avec de l’humour et de l’émotion
– car je n’ai jamais vu des silhouettes de papier découpé
gigoter : j’ai toujours ressenti une proximité avec ses personnages,
jusqu’à être bouleversé quand Lucky Luke, visiblement
ému, ne parvient pas à rouler sa cigarette pendant la lecture
du testament du vieux Baldy dans Le Pied-tendre…
J’ai eu rapidement une collection de bandes dessinées fournie,
qui est devenue une espère de bibliothèque de prêt
pour tous mes copains.
Quand avez-vous commencé à dessiner ?
Tout de suite ! « Crayon » a été un
des premiers mots que j’ai prononcés. J’ai donc très
vite réclamé de quoi travailler et j’ai dessiné
beaucoup avant même d’aller en classe, sans que mes parents
se rendent vraiment compte, croyant que je gribouillais comme tous les
enfants. J’ai grandi dans ce qui s’appelait encore les Basses-Alpes,
le pays de Giono. A mon entrée à l’école, la
maîtresse est passée derrière moi et m’a glissé :
(prenant l’accent provençal) « Il faudra que
tu dises à ta mère de venir me voir. » Comme
elle ne m’en a pas dit plus, j’étais dans mes petits
souliers, croyant avoir fait une bêtise. Le lendemain, la maîtresse
a dit à ma mère : « Votre fils ne dessine
pas comme les autres enfants. Il y a dans ses dessins de la perspective,
de la profondeur de champ… Il n’y a rien à faire, mais
sachez-le : il est spécial. » La première
réaction de mon père fut amusante : alors que j’avais
cinq ou six ans, il m’a emmené le samedi suivant chez un
fournisseur d’art et m’a acheté un chevalet et un petit
manuel pour savoir dessiner les animaux sauvages, que j’ai toujours.
Tout cela s’est évidemment échoué dans un coin
de ma chambre, parce que j’ai continué à faire ce
que j’avais toujours fait, c’est-à-dire dessiner à
plat-ventre sur le tapis. Je n’ai plus arrêté. La saga
familiale, les aventures de mes parents et grands-parents, constituait
le terreau des histoires que je racontais en dessins. Je ne savais pas
encore écrire que je dessinais déjà des bulles avec
des gribouillis dedans ! Cela venait bien entendu des bandes dessinées
dont on me faisait la lecture alors que je ne savais pas encore lire :
je me rappelle ma grand-mère Jeannine me lisant Objectif Lune
et On a marché sur la Lune quand j’avais peut-être
quatre ans et j’ai encore dans l’oreille toute la tirade de
Tournesol sur le zouave, puisqu’elle faisait toutes les voix.
Par la suite, comment avez-vous perfectionné votre pratique
précoce ?
En copiant, bien sûr. Copier ne m’a jamais donné très
bonne conscience. Je pensais que ce n’était pas très
bien. Je me faisais des posters pour ma chambre, avec des Lucky Luke,
etc. J’ai même fait des bandes dessinées où
j’ai utilisé des cases du Totoche de Tabary, en
remplaçant les noms par ceux des copains pour en faire une saga
personnelle. A côté de ça, je créais mes héros
et dessinais mes histoires qui n’allaient jamais bien loin car le
problème de l’enfance est qu’on se lasse vite des histoires…
mais j’ai bouclé des histoires de cinq ou six pages vers
onze-douze ans.

Faisiez-vous déjà des recherches techniques ?
Comme aujourd’hui, j’ai toujours été accablé
par mon incapacité à maîtriser les choses. Ça
n’allait jamais. Je me rappelle ma conscience douloureuse de ne
pas pouvoir tracer un cercle parfait à main levée quand
j’étais petit ! Ou encore l’abîme de doute
dans lequel me plongeait un personnage de Disney se découpant sur
un ciel uniformément bleu. Je ne savais pas qu’on utilisait
des masques, je ne connaissais pas la technique de l’aplat, les
pistolets à projection… J’essayais donc de reproduire
avec mes faibles moyens des choses qui me paraissaient éblouissante,
et mon arrière-plan était pourri, on voyait les raccords…
Moins j’y arrivais, plus ça m’excitait et plus j’essayais :
c’est comme ça qu’on progresse, qu’on découvre
ses propres techniques… C’est ce mécontentement chronique
que j’ai de ne pas pouvoir vraiment atteindre une espèce
d’aisance absolue (qui serait d’ailleurs certainement le comble
de l’ennui), qui me pousse à continuer à chercher
des solutions.
En dehors de la bande dessinée, avez-vous eu un autre apprentissage
de l’art ?
Oui, on m’a emmené voir des expositions ; à la
maison, les livres sur la peinture me plaisaient beaucoup. Mais je ne
faisais pas vraiment la différence : toute cela, c’était
des choses que j’avais envie de faire. Si je fais plutôt de
la bande dessinée que de la peinture, c’est que visiblement
cette voie m’a plus excité que toute autre, sans doute d’abord
parce que je voulais raconter des histoires. Comme Goscinny !
Avez-vous en mémoire une grande découverte graphique ?
J’en ai eu beaucoup. Mais principalement, comme toute ma génération,
Disney et Hergé. Un peu plus tard Franquin, Morris et les autres.
Evidemment, ce sont les plus connus, donc ceux qu’on nous met sous
le nez le plus tôt… Après, il y eut quelqu’un
dont on ne parle plus assez, c’est Gotlib !
Et en littérature ?
Une fois passée l’époque des bibliothèques
Rose et Verte, Oui-Oui, Le Club des Cinq, j’ai commencé
par lire Pagnol, puis ai beaucoup aimé la littérature policière
accessible aux enfants comme Agatha Christie, Gaston Leroux, Raymond Leblanc…
Puis j’ai l’impression que je suis tombé du jour au
lendemain dans une autre littérature. Je me revois à l’arrière
d’une voiture en train de lire L’Âge de raison
de Sartre : je devais avoir treize ou quatorze ans… Toujours avec
cette opiniâtreté qui me caractérise, je pouvais m’envoyer
des plâtrées jusqu’à m’en rendre saoul,
mais avec la volonté d’aller jusqu’au bout. Et j’ai
fait des rencontres prodigieuses : Stevenson, Proust que je relis
maintenant... J’aime bien le cinéma, j’aime beaucoup
la musique, mais la lecture est sans doute ce qui me convient le mieux.
Quelles furent vos études ?
Bac littéraire, puis une année de préparation aux
Arts Déco à l’école Hourdé, parce qu’il
était convenu avec mes parents que je devrais être diplômé
dans l’ordre de ce que je désirais faire, et parce que les
Arts-Décoratifs avaient bonne réputation. J’ai eu
le concours et suis resté six mois aux Arts Déco, que j’ai
quittés parce que j’ai commencé à travailler
très fort. Et aussi parce que dans ces premières années
dites « de tronc commun » où l’on est
censé tout faire pour se déterminer, si l’on arrive
fortement déterminé comme je l’étais, ça
ne peut pas très bien se passer. Ce que l’on aime – en
l’occurrence la bande dessinée – a tendance à
se rendre assez visible aussi bien dans les façons de faire que
de se comporter, ce qui peut prendre un certain nombre de professeurs
à rebrousse-poil. Je n’ai pas eu affaire à une hostilité
particulière, mais comme je travaillais la nuit dans des agences
où je faisais des illustrations et des story-boards, je faisais
aussi de la bande dessinée et un petit journal avec des copains,
je n’avais plus le temps de rendre les travaux demandés et
les profs me demandaient de choisir entre eux et le boulot. A un âge
où l’on a vraiment envie de se prouver qu’on peut commencer
à gagner se vie, on se dit qu’on aura une vraie reconnaissance.
Si un prof vous note mal, vous vous dites que c’est un idiot ; s’il
vous note bien il vous reste un doute : « Oui, mais que
se passera-t-il lorsque je serai vraiment en situation d’avoir à
faire mes preuves ? ». Dès que cette situation
s’est présentée, je suis parti.

La préparation et ces six mois d’école ont-ils
apporté quelque chose à votre pratique ?
Ça n’a pas été négligeable. D’abord
je me suis fait des potes, notamment un ami merveilleux, Frédéric
Lemercier, avec lequel je vais enfin essayer de faire de la bande dessinée,
ce que nous n’avions jamais réussi à faire, car c’est
un pur graphiste, même essentiellement un typographe, merveilleux
metteur en page. C’est excitant.
Quel genre de travail faisiez-vous la nuit ?
Principalement du story-board pour des vidéo-clips ou des films.
C’était une façon de faire mes armes, pas si éloignée
de la bande dessinée, rémunératrice… C’était
amusant à faire. Et puis j’ai rencontré les gens d’Albin
Michel qui m’ont demandé de faire un album. Ce fut Brune.
Les croquis d’observation
La grâce de notre boulot, c’est que lorsque l’on est concentré sur son dessin, on est au plus profond de soi-même, et en même temps on est parti. Et je trouve qu’il n’y a rien de tel. Mais après une période où on a beaucoup exprimé, il faut de nouveau absorber : après Brune, l’éponge était vraiment pressée et le besoin se faisait sentir de telle façon, que j’ai décidé du jour au lendemain de faire du dessin d’observation « disciplinairement », c’est-à-dire de façon systématique : au bas mot un croquis par jour pendant un certain temps. Je me suis donc acheté une belle pile de carnets, je suis sorti avec et ai commencé à dessiner ce qu’il y avait autour de moi. J’ai tenu longtemps, puis j’ai relâché la ceinture, mais je continue à le faire très régulièrement. C’est ce qui m’a fait le plus de bien ces dix dernières années, ça m’a apporté énormément : aujourd’hui mon dessin me remercie de m’être mis dans l’œil un certain nombre de choses par le biais des dessins d’observation exécutés depuis dix ans. De plus, le fait d’utiliser des techniques qui contrarient le papier, avec des outils inattendus… m’a fait aussi découvrir des procédés que j’ai ensuite réutilisés dans mes albums. En faisant ces croquis, je sens le dessin se libérer, se dilater, aller plus aisément dans des zones où il ne s’aventurait pas auparavant. Il y a des royaumes qui se refusent à vous pendant un certain temps ; il y en a dont je me sens toujours exclu. Le cheval, par exemple : j’en ai dessiné pas mal, mais ce n’est pas mon monde. Les mains, pendant un certain temps, n’ont pas été mon monde. Et un jour j’ai pénétré dans le monde des mains, grâce au croquis. Plus précisément par l’observation : le croquis n’existe pas, c’est la trace qui reste d’un moment où on a regardé quelque chose. C’est à cela qu’il sert. Le drapé est un bon exemple de son utilité : si on aime la bande dessinée, quand on est gosse, on se colle dans l’œil les techniques des auteurs qu’on admire. On a ainsi vu des générations de gens qui ont dessiné des vêtements d’après Jacobs, en ayant recours à des solutions qui ne sont pas senties, pas comprises, pas satisfaisantes… Jusqu’au jour où on commence vraiment à se coltiner une épaule, un bras plié, le pli d’un pantalon… Je suis étonné du plaisir et de la satisfaction qu’a pu m’apporter, certains après-midi, le dessin du pantalon d’un gusse pendant un trajet en métro. Et puis à la prochaine station, il va emporter ses jambes avec lui : il faut donc faire vite…

Allez-vous donner un prolongement éditorial à ces
travaux d’observation ?
 En octobre va sortir mon premier livre de croquis, aux éditions
Ouest France (La Campagne à la mer), qui sera peut-être
le premier d’une série, si tout va bien. C’est un gros
boulot de sélection de dessins, d’autant que j’ai souhaité
les associer à mes carnets d’écriture, remplis de
croquis littéraires (procès verbaux de conversations notés
tels quels, proverbes glanés ici et là, etc.). On a décidé
de commencer par un livre de 150 pages sur la Normandie.
En octobre va sortir mon premier livre de croquis, aux éditions
Ouest France (La Campagne à la mer), qui sera peut-être
le premier d’une série, si tout va bien. C’est un gros
boulot de sélection de dessins, d’autant que j’ai souhaité
les associer à mes carnets d’écriture, remplis de
croquis littéraires (procès verbaux de conversations notés
tels quels, proverbes glanés ici et là, etc.). On a décidé
de commencer par un livre de 150 pages sur la Normandie.
Est-ce de cette pratique que vient le passage du dessin presque
hyper-réaliste de Brune à un dessin plus expressif
mais beaucoup plus économe ?
Sans doute le croquis, mais aussi la « bouteille »,
l’expérience. Je prépare un livre avec un copain photographe.
Nous allons procéder comme avec Alan : j’ai enregistré
ce copain et lui ai demandé de m’expliquer pourquoi il était
reporter photographe. Nous avons découvert que nous étions
cousins : il photographie, je croque… (nous nous sommes même
posé la question de voyager ensemble…). Et nous sommes arrivés
à la conclusion que pour bien photographier, pour bien dessiner,
il faut bien vieillir, c’est-à-dire qu’il ne faut pas
se racornir, se scléroser, se renfermer, il faut rester en vie.
Pour que le dessin reste vif, il faut régulièrement se donner
un coup de pied aux fesses, parce que notre existence – en
tout cas la mienne –, si elle est très agréable,
peut aussi avoir un côté lénifiant. Quiconque, quoi
qu’il fasse, est menacé par le train-train. Le croquis a
servi à cela aussi : une aération pour que le dessin reste
une émanation de moi, qu’il exprime ma présence au
monde…
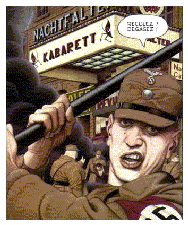 Pour
répondre sur l’économie de moyens, il est sûr
que lorsqu’on se met à comprendre mieux, on synthétise
mieux. Généralement, quand on en remet beaucoup, c’est
qu’on tourne autour de quelque chose de problématique. Quand
une partie du voile se lève, cela permet tout simplement de passer
à autre chose. Dans une Brune, tout – les anatomies,
les perspectives… – cherche à affleurer à
la surface, à prendre sa place : il est clair que je ne me
sens à l’aise avec rien de tout cela, je me sens incapable
de m’en sortir, tout en ayant une fringale de le faire. Donc j’essaye
de tout border, au détriment de ce que je raconte. Puis vient le
moment où cette nécessité se fait moins forte parce
que l’essentiel se dégage, en l’occurrence la nécessité
de raconter bien une histoire et parce que votre dessin, s’il a
bien évolué, vous sert dans ce propos en allant plus naturellement
à l’essentiel.
Pour
répondre sur l’économie de moyens, il est sûr
que lorsqu’on se met à comprendre mieux, on synthétise
mieux. Généralement, quand on en remet beaucoup, c’est
qu’on tourne autour de quelque chose de problématique. Quand
une partie du voile se lève, cela permet tout simplement de passer
à autre chose. Dans une Brune, tout – les anatomies,
les perspectives… – cherche à affleurer à
la surface, à prendre sa place : il est clair que je ne me
sens à l’aise avec rien de tout cela, je me sens incapable
de m’en sortir, tout en ayant une fringale de le faire. Donc j’essaye
de tout border, au détriment de ce que je raconte. Puis vient le
moment où cette nécessité se fait moins forte parce
que l’essentiel se dégage, en l’occurrence la nécessité
de raconter bien une histoire et parce que votre dessin, s’il a
bien évolué, vous sert dans ce propos en allant plus naturellement
à l’essentiel.

Raconter des histoires
Quelle fut votre part dans le scénario de ce premier album ?
J’ai écrit Brune d’après un scénario
qu’on m’avait donné. J’ai fait ma sauce à
partir d’une chose avec laquelle je n’étais pas très
d’accord. C’est la faute à l’âge que j’avais
à ce moment-là (vingt ans).
Par la suite, pour raconter des histoires, vous avez multiplié
les types de relation entre scénariste et dessinateur, étant
tour à tour illustrateur de scénarios de Joann Sfar ou David B.,
adaptateur des propos d’Alan, scénariste pour Sfar encore
ou pour Marc Boutavant…
Quand j’ai commencé à faire ce métier, je pensais
que je travaillerais toujours seul. Peut-être parce qu’aux
Arts Déco je n’ai pas rencontré de gens comme moi
: il ne m’est pas arrivé ce qui est arrivé plus tard
aux gens de l’Association. J’ai donc longtemps cru que je
serais tout seul. Quand, du jour au lendemain, j’ai rencontré
les gens de l’atelier, j’ai vu des gens tellement talentueux
que je me suis dit « Voilà des amis, travaillons
ensemble ! » Je pense qu’un jour je ferai les
deux, mais je suis tellement plein d’admiration pour ce que font
Joann ou David que je ne me force pas à le faire plus vite : ça
viendra en son temps.
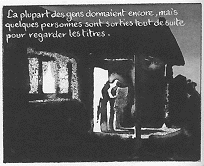 Je reconnais la même légitimité au travail sur Alan :
j’ai rencontré, en écoutant ce septuagénaire
me raconter sa vie, tant de résonances en moi avec des choses très
intimes, qui correspondent tellement à ce que je veux dire sur
la vie, que j’ai pensé « qu’il le dise ou
que je le dise, c’est pareil.» Dans la formation de tout
artiste, il est un temps où il est infantilisé par les grandes
œuvres : « Oh là là, des mecs ont fait
ça, à quoi bon se lancer, je ne serai jamais à la
hauteur… » Puis on se dit : « Ils
l’ont fait, donc c’est fait, déposé, consultable. »
D’infantilisant, cela devient libérateur : « A
moi de faire aussi quelque chose, à côté, qui restera
ou pas, peu importe. » L’essentiel est que des gens
puissent dire quelque chose de l’ordre de l’expérience
humaine, et que ça reste. Alan n’a pas eu ma vie, on était
différents, mais on avait suffisamment de choses en commun pour
se comprendre et s’apprécier, et il a dit des choses sur
l’enfance, la sortie de l’enfance qui m’ont suffisamment
marquées pour j’en sois plus que le témoin. Je n’ai
pas l’impression de servir un autre propos que le mien en racontant
les histoires d’Alan – et en même temps ça
m’a donné cette liberté que l’on a quand on
déforme la parole d’un autre. Il m’est parfois difficile
de justifier devant autrui ma propre parole (comme je dois le faire en
répondant à des questions sur mon premier album, par exemple…)
mais je n’ai aucune difficulté à parler d’Alan
parce que c’est Alan – et pourtant il est clair qu’en
même temps c’est moi. Parce que c’est lui, l’énergie
qui est la mienne lorsque je me mets au travail sur ses pages est intacte
lorsque je dois en parler. Par sa présence, Alan a rendu extrêmement
précieux des moments de mon existence. Le travail que je fais aujourd’hui
consiste essentiellement à rester avec lui. Sa parole a la qualité
qu’ont les grands conteurs ou les grands littérateurs, qui
est d’être une parole vivante. Quand les premières
histoires ont paru dans Lapin, j’avais déjà
quelques soutiens non négligeables, à commencer par celui
de Jean-Christophe Menu à L’Association, mais beaucoup de
gens me disaient « Mais il n’y a rien, là-dedans…
Ça ne raconte rien… » Mais j’étais
confiant. Je pense qu’on peut encore dire ça au bout de 160
pages, mais après 500 ou 700 pages on reconnaîtra la valeur
de sa parole.
Je reconnais la même légitimité au travail sur Alan :
j’ai rencontré, en écoutant ce septuagénaire
me raconter sa vie, tant de résonances en moi avec des choses très
intimes, qui correspondent tellement à ce que je veux dire sur
la vie, que j’ai pensé « qu’il le dise ou
que je le dise, c’est pareil.» Dans la formation de tout
artiste, il est un temps où il est infantilisé par les grandes
œuvres : « Oh là là, des mecs ont fait
ça, à quoi bon se lancer, je ne serai jamais à la
hauteur… » Puis on se dit : « Ils
l’ont fait, donc c’est fait, déposé, consultable. »
D’infantilisant, cela devient libérateur : « A
moi de faire aussi quelque chose, à côté, qui restera
ou pas, peu importe. » L’essentiel est que des gens
puissent dire quelque chose de l’ordre de l’expérience
humaine, et que ça reste. Alan n’a pas eu ma vie, on était
différents, mais on avait suffisamment de choses en commun pour
se comprendre et s’apprécier, et il a dit des choses sur
l’enfance, la sortie de l’enfance qui m’ont suffisamment
marquées pour j’en sois plus que le témoin. Je n’ai
pas l’impression de servir un autre propos que le mien en racontant
les histoires d’Alan – et en même temps ça
m’a donné cette liberté que l’on a quand on
déforme la parole d’un autre. Il m’est parfois difficile
de justifier devant autrui ma propre parole (comme je dois le faire en
répondant à des questions sur mon premier album, par exemple…)
mais je n’ai aucune difficulté à parler d’Alan
parce que c’est Alan – et pourtant il est clair qu’en
même temps c’est moi. Parce que c’est lui, l’énergie
qui est la mienne lorsque je me mets au travail sur ses pages est intacte
lorsque je dois en parler. Par sa présence, Alan a rendu extrêmement
précieux des moments de mon existence. Le travail que je fais aujourd’hui
consiste essentiellement à rester avec lui. Sa parole a la qualité
qu’ont les grands conteurs ou les grands littérateurs, qui
est d’être une parole vivante. Quand les premières
histoires ont paru dans Lapin, j’avais déjà
quelques soutiens non négligeables, à commencer par celui
de Jean-Christophe Menu à L’Association, mais beaucoup de
gens me disaient « Mais il n’y a rien, là-dedans…
Ça ne raconte rien… » Mais j’étais
confiant. Je pense qu’on peut encore dire ça au bout de 160
pages, mais après 500 ou 700 pages on reconnaîtra la valeur
de sa parole.
Mais contrairement aux scénaristes que sont Joann Sfar
ou David B., Alan est un orateur qui ne vous donne pas des histoires à
dessiner, et qui n’a pas sur votre travail le regard de dessinateur
qu’ont les autres. Cela fait-il une différence ?
 La
grande différence, c’est que c’était ses souvenirs
que j’apportais à Alan sous forme de dessins. Aussi troublante
que puisse être la confrontation, il joua le jeu à 100% dès
les premiers dessins qu’il vit. Même s’ils ne coïncidaient
pas avec ce qu’il avait vécu, il considérait que c’était
ma part et que j’avais toute latitude de faire ce que je voulais.
Il m’a juste repris sur des éléments techniques très
spécifiques. Alan avait une sensibilité artistique très
développée. Il a écrit des poèmes, fait de
la poterie, joué du piano… mais toute sa vie a comploté
à le détourner de sa vocation. En revanche, il admirait
l’expression artistique des autres. Cela a d’ailleurs contribué
à atténuer la différence d’âge qui nous
séparait en lui faisant adopter une position de respect et de superstition
vis-à-vis de moi, miroir de celle que je pouvais avoir vis-à-vis
d’un homme de soixante-dix ans couturé de partout…
Cela nous a aidé à avoir le même âge dans nos
conversations.
La
grande différence, c’est que c’était ses souvenirs
que j’apportais à Alan sous forme de dessins. Aussi troublante
que puisse être la confrontation, il joua le jeu à 100% dès
les premiers dessins qu’il vit. Même s’ils ne coïncidaient
pas avec ce qu’il avait vécu, il considérait que c’était
ma part et que j’avais toute latitude de faire ce que je voulais.
Il m’a juste repris sur des éléments techniques très
spécifiques. Alan avait une sensibilité artistique très
développée. Il a écrit des poèmes, fait de
la poterie, joué du piano… mais toute sa vie a comploté
à le détourner de sa vocation. En revanche, il admirait
l’expression artistique des autres. Cela a d’ailleurs contribué
à atténuer la différence d’âge qui nous
séparait en lui faisant adopter une position de respect et de superstition
vis-à-vis de moi, miroir de celle que je pouvais avoir vis-à-vis
d’un homme de soixante-dix ans couturé de partout…
Cela nous a aidé à avoir le même âge dans nos
conversations.
Dans mon travail avec Joann ou David, il y a un côté qui
s’adresse à chacun d’eux et à la connaissance
que j’ai d’eux-mêmes et de leurs goûts. Le côté
épistolaire de la bande dessinée est très plaisant :
tu m’envoies mon scénario, je te renvoie mon dessin…
ce sont des lettres qu’on s’adresse.
Quelles sont les différences entre les cartes postales
que vous envoyez à Joann et celles que vous envoyez à David ?
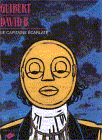 David
m’a fait refaire ma première planche du Capitaine écarlate.
A partir du moment où on a été d’accord, il
était un spectateur heureux. Avec Joann, c’est toujours plus
chaotique parce qu’on se travaille au corps, on s’observe…
Pour La Fille du professeur, j’étais très
présent sur le scénario : j’ai même écrit
des pages, suggéré des modifications sur ses textes, ce
qui était facilité par le fait que nous travaillions côte
à côte à l’atelier. On se prenait le bec pour
le bien de l’histoire. Quand on a recommencé à travailler
ensemble sur Les Olives noires, j’ai eu quelques velléités
à recommencer, mais il m’a bien remis à ma place,
en quoi il a eu parfaitement raison. Maintenant je suis dans une logique
de tentative de compréhension la plus aiguë possible de ce
qu’il me propose : le texte arrive, pas question d’y toucher,
il faut simplement le porter, servir par l’image. Et Joann ne me
passe rien.
David
m’a fait refaire ma première planche du Capitaine écarlate.
A partir du moment où on a été d’accord, il
était un spectateur heureux. Avec Joann, c’est toujours plus
chaotique parce qu’on se travaille au corps, on s’observe…
Pour La Fille du professeur, j’étais très
présent sur le scénario : j’ai même écrit
des pages, suggéré des modifications sur ses textes, ce
qui était facilité par le fait que nous travaillions côte
à côte à l’atelier. On se prenait le bec pour
le bien de l’histoire. Quand on a recommencé à travailler
ensemble sur Les Olives noires, j’ai eu quelques velléités
à recommencer, mais il m’a bien remis à ma place,
en quoi il a eu parfaitement raison. Maintenant je suis dans une logique
de tentative de compréhension la plus aiguë possible de ce
qu’il me propose : le texte arrive, pas question d’y toucher,
il faut simplement le porter, servir par l’image. Et Joann ne me
passe rien.
Pourquoi, pour cette histoire, être passé à
la plume ?
 Parce
que j’avais l’impression de cacher un peu mon trait derrière
le lavis et mille techniques qui n’étaient pas l’épure
du trait. J’ai conservé l’intermédiaire du crayonné,
que j’ai finalement abandonné pour Sardine de l’espace,
puisque j’en reprends le dessin : je débouche mon stylo à
bille, j’écris du texte en haut à gauche des cases
et je dessine en dessous. Ce n’est pas la technique de Joann, ni
son format, puisque je travaille au format de parution.
Parce
que j’avais l’impression de cacher un peu mon trait derrière
le lavis et mille techniques qui n’étaient pas l’épure
du trait. J’ai conservé l’intermédiaire du crayonné,
que j’ai finalement abandonné pour Sardine de l’espace,
puisque j’en reprends le dessin : je débouche mon stylo à
bille, j’écris du texte en haut à gauche des cases
et je dessine en dessous. Ce n’est pas la technique de Joann, ni
son format, puisque je travaille au format de parution.
Sardine de l’espace était
destiné à un dessinateur très particulier. En reprenant
le dessin, avez-vous changé d’approche ?
 Pas
du tout. Joann et moi aspirons à écrire l’un pour
l’autre comme on écrirait pour soi. Et même si l’on
écrit pour quelqu’un, avec son esprit, son graphisme, on
commence par écrire seul et pour soi-même. Curieusement,
alors que Sardine est de loin ma série la plus fournie,
puisque j’ai dépassé les 500 pages, je n’ai
pas l’impression de plus maîtriser le scénario aujourd’hui
qu’au début. Chaque scénario est achevé à
l’arrachée, sans jamais la certitude que le suivant sera
à la hauteur ou même viendra… Mais j’ai avec
les personnages la familiarité que l’on a avec quelqu’un
qui vit avec vous depuis cinq ans, ce qui me déleste d’un
certain nombre d’interrogations ou d’angoisses que je pouvais
avoir au début.
Pas
du tout. Joann et moi aspirons à écrire l’un pour
l’autre comme on écrirait pour soi. Et même si l’on
écrit pour quelqu’un, avec son esprit, son graphisme, on
commence par écrire seul et pour soi-même. Curieusement,
alors que Sardine est de loin ma série la plus fournie,
puisque j’ai dépassé les 500 pages, je n’ai
pas l’impression de plus maîtriser le scénario aujourd’hui
qu’au début. Chaque scénario est achevé à
l’arrachée, sans jamais la certitude que le suivant sera
à la hauteur ou même viendra… Mais j’ai avec
les personnages la familiarité que l’on a avec quelqu’un
qui vit avec vous depuis cinq ans, ce qui me déleste d’un
certain nombre d’interrogations ou d’angoisses que je pouvais
avoir au début.
Il m’est d’ailleurs arrivé une mésaventure :
il a été question d’une série animée
tirée de Sardine alors même qu’un seul épisode
était paru ; j’ai dû pour cela réaliser une
« Bible », ce truc qui décrit la façon
de s’habiller, la marque de brosse à dents… toutes
choses que je ne savais pas, ne voulais pas savoir pour les découvrir
au fur et à mesure… Ce fut cauchemardesque ! Je me suis
empressé d’oublier tout ce que j’ai dû faire
à ce moment-là à propos de la série – et
pratiquement rien n’a été exploitable par la suite
dans les histoires de Sardine proprement dites.
Je suis content de cela reste une petite bande dessinée dizaine
de pages avec un maximum de quatre ou cinq cases par page, parce que c’est
une distance, peu évidente, que j’ai fini par maîtriser
: en dix petites pages pour enfants je peux déjà raconter
une histoire, qui doit être très rapide mais peut être
assez substantielle… J’ai été le premier surpris
de devenir le scénariste de cette série. Sardine est un
personnage créé par Joann, ainsi que P’tit Lulu, Supermuscleman
ou le Capitaine Epaule Rouge, lequel se retrouve dans d’autres de
ses séries ; j’ai créé le docteur Krok et quelques
autres… Joann est arrivé à l’atelier avec ses
petits personnages ; il a téléphoné à Alain
Ayroles pour lui dire « Je voudrais faire une bande dessinée
pour enfants, mais je voudrais que quelqu’un l’écrive. »
Je l’ai vu tristouille de s’être fait envoyer aux pelotes
par Alain et je lui ai proposé de m’en occuper. Il a pris
ça pour une énormité, car il ne me voyait pas dans
ce rôle – pas plus que je ne m’y voyais, d’ailleurs
! Mais je ne me vois dans aucun rôle ; je suis prêt à
tout pour peu que ce soit avec quelqu’un que j’aime bien…
J’en ai un peu sué au début mais nous avons très
vite trouvé notre rythme de croisière et je me suis rendu
compte que j’adorais écrire ces petites histoires pour les
enfants, rigolotes, débridées, qui partent dans tous les
sens… 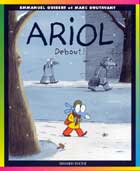 Quand
j’ai créé Ariol, j’ai fait en sorte
que ce soit complètement différent de Sardine,
afin que je ne puisse pas me demander si une histoire conviendrait mieux
à une série ou à l’autre. Un certain type d’imaginaire
d’un côté, de l’autre un univers beaucoup plus
proche d’Alan et de ma propre enfance, d’où je tire
personnages et anecdotes. Je me souviens de la déflagration qu’a
provoqué en moi Le Petit Nicolas. Jusque-là, je
m’amusais bien avec mes copains. Mais soudain, la découverte,
à neuf ans, de la caractérisation de chacun, de ces traits
d’humour permanents sur toutes les aventures vécues dans
une journée… a décuplé ma propre vie et a apporté
à mon enfance l’impression consciente de vivre une saga.
J’ai commencé à voir mes copains comme Alceste, Alexandre
et Joachim… Et j’ai toujours eu dans un coin de la tête
l’idée d’écrire des histoires dans cet esprit,
ce qui est un peu ce que j’essaie de faire.
Quand
j’ai créé Ariol, j’ai fait en sorte
que ce soit complètement différent de Sardine,
afin que je ne puisse pas me demander si une histoire conviendrait mieux
à une série ou à l’autre. Un certain type d’imaginaire
d’un côté, de l’autre un univers beaucoup plus
proche d’Alan et de ma propre enfance, d’où je tire
personnages et anecdotes. Je me souviens de la déflagration qu’a
provoqué en moi Le Petit Nicolas. Jusque-là, je
m’amusais bien avec mes copains. Mais soudain, la découverte,
à neuf ans, de la caractérisation de chacun, de ces traits
d’humour permanents sur toutes les aventures vécues dans
une journée… a décuplé ma propre vie et a apporté
à mon enfance l’impression consciente de vivre une saga.
J’ai commencé à voir mes copains comme Alceste, Alexandre
et Joachim… Et j’ai toujours eu dans un coin de la tête
l’idée d’écrire des histoires dans cet esprit,
ce qui est un peu ce que j’essaie de faire.
Vous le faites en vous inscrivant dans un genre dont vous respectez
les codes. A l’inverse, La Guerre d’Alan n’est
pas une bande dessinée de guerre, Les Olives noires ne
sont pas un péplum, Le Capitaine écarlate n’est
pas ni une histoire de pirates ni une biographie d’écrivain.
Certes, mais Ariol, est-ce vraiment des histoires pour enfants ?
Je ne peux pas dire que j’écrive pour les enfants. Chez les
grands auteurs que j’admire, Hergé, Goscinny, Franquin, je
ressens tellement le côté journal intime, je me suis senti
tellement de plain-pied avec leur existence, qu’il faut bien qu’ils
aient mis dans leurs livres autre chose que l’idée toute
faite qu’on se fait d’une littérature destinée
aux enfants. Quand on voit apparaître une énième série
pour enfants conçue vite fait pour les besoins de remplissage d’un
magazine, il y a de fortes chances pour qu’on se retrouve avec une
bande de gamins dont l’un est un peu gros, un autre porte des lunettes,
le troisième est une fille… ou alors avec des animaux qui
gambadent… Il y a un certain nombre de passages obligés,
qui peuvent être honnêtement faits, mais qui sont un peu du
« à la manière de » et qui vivent
en sangsues sur une tradition… De temps en temps – et
c’est vraiment ce que j’essaie de faire – des auteurs
se disent « Racontons notre vie de façon suffisamment
simple et cristalline pour que ça fasse rire les enfants. »
Si par le travail et l’entraînement on parvient à être
de plus en plus léger et marrant, on peut raconter des choses de
plus en plus sérieuses. Dans Sardine par exemple, je me
mets à écrire des épisodes sur les hospices, sur
l’adultère… Il n’y a aucune volonté transgressive,
par exemple parce que l’éditeur serait une boîte catho…
Parce qu’une bonne bande dessinée est porteuse de toutes
les dimensions de l’existence, je cherche un moyen, dans la tradition
du conte pour enfant, d’aborder tout ce qui fait la richesse et
le quotidien d’un homme fait, mais en le présentant de façon
accessible aux enfants. Une enfance vraiment réussie est remplie
d’exemples, d’engrais qui donnent envie de pousser et d’aller
voir plus loin ce qui va se passer. Bien évidemment il faut que
le soufflé ne retombe pas et que l’on puisse continuer à
trouver dans la vie des aliments qui donnent envie d’aller plus
loin. La rencontre avec Alan est de cet ordre : c’est très
important de rencontrer des personnes âgées qui ne font pas
désespérer de vieillir !
En parlant de genre, je pensais plutôt à la sphère
des kid strips qu’à celle des histoires « pour
enfants »…
D’accord. J’ai une ambition dans Ariol, qui consiste
à aborder à ma façon des questions et des histoires
qui n’appartiennent pas forcément à ce genre. Je me
rends compte par exemple que ce ne sont pas des « histoires
à chute », et il leur faut néanmoins une chute.
Je m’en tire toujours par une pirouette, mais ces histoires ne devraient
pas finir, ce sont des instants piqués dans la vie d’Ariol.
Suspendre le récit, suspendre la parole, comme dans Alan,
où certains épisodes se terminent comme si le téléphone
avait interrompu votre enregistrement...
Il n’y a pas de véritables « procédés
narratifs ». La question est toujours de savoir quand s’arrêter,
où s’arrêter. Au sein d’un même épisode
d’Alan, je passe par des petites émotions, des moments
où il raconte des choses qui se passent. Mais ces pics arrivent
rarement à la fin. Je me rends compte que lorsque la fin d’une
histoire n’est pas à la hauteur, elle a tendance à
oblitérer, dans l’esprit du lecteur, le souvenir qu’ils
ont du parcours qu’ils viennent d’effectuer en la lisant :
si ça retombe, si c’est mou à la fin, on ne sait pas
gré à l’auteur de nous avoir quand même intéressé
à divers moments dans l’histoire. Je trouve au contraire
qu’il y a quelque chose de très vivant à ne pas tenir
constamment les promesses d’un récit ; je dirais même
que les moments de vasouillage sont nécessaires aux regains d’intérêt...
La bande dessinée étant un mode d’expression souvent
bref, on devait souvent se situer dans un paroxysme permanent. A partir
du moment où on ne se limite plus à la quarantaine de pages
des albums classiques, on peut se permettre de raconter un temps mort.
J’ai adoré, dans Alan, dessiner un trou de mémoire.
Et l’épisode se conclut quand Alan se souvient du nom d’un
philosophe qu’il ne retrouvait pas.
Comment se déroule votre travail de transcription des paroles
d’Alan ?
Je fais d’abord un décryptage systématique, où
je consigne le moindre grommellement. Alan me parlait français,
celui qu’on peut lire dans les albums : un français
qui sent un peu son étranger, mais qui est merveilleusement nuancé.
Je relis constamment mes petits carnets. Puis je m’attaque à
une période, je vais chercher dans l’ensemble des carnets
ce qui a trait à cette période, que j’essaie de remettre
dans l’ordre chronologique, dont je rapproche les différentes
versions (on a parlé cinq ans ensemble, et il a raconté
certains épisodes plusieurs fois). J’en choisis les éléments
les plus juteux, les plus significatifs, les mieux exprimés. Une
fois que j’ai mis bout à bout ces anecdotes, j’écris
en employant rigoureusement ses mots (parfois il me corrigeait par la
suite) et en les distribuant dans les cases.

Preniez-vous des notes pendant vos conversations enregistrées ?
Je faisais des croquis. D’Alan en train de parler, de son environnement…
et de temps en temps, quand le besoin s’en faisait sentir, il me
faisait un petit dessin si je lui demandais de me préciser quelque
chose : un grade, sa gamelle, sa façon de tenir sa mitrailleuse.
Je fais ce travail à sa mémoire, au double sens de le maintenir
en vie et de célébrer la mémoire colossale de cet
homme.
Du graphisme et du style
La Guerre d’Alan évoque parfois certains
modèles américains, des burlesques tel que Harold Lloyd
aux dessinateurs comme Norman Rockwell ou Will Eisner.
Le principe de base pour la période de la guerre, c’est que
je n’avais rien contre le fait de replacer le lecteur dans une certaine
imagerie. Je suis conscient que je transmets un récit qui ne ressemble
pas aux récits traditionnels de guerre, et je me dis qu’il
faut placer le lecteur dans un bain familier pour lui raconter d’autant
mieux des choses qui vont lui paraître surprenantes, par leur aspect
quotidien par exemple. C’est pourquoi j’ai adopté le
sépia qui rappelle les documents d’archives de cette époque,
un aspect granuleux qui peut évoquer des photographies un peu détériorées
de Capa… C’est en cela aussi que les artistes américains
que j’ai aimés ont pu ressurgir, par capillarité.
Si l’on évoque Rockwell, il est évident que je n’aurais
pas voulu, pour raconter Alan, tomber dans le défaut de mon premier
album en adoptant le souci « rockwellien » du détail.
En revanche, ce qui tord le cou à son réalisme maniaque,
c’est son humour, sa capacité à saisir, avec maniérisme,
le moment le plus significatif où le moindre orteil, la moindre
mèche de cheveux vont traduire l’état d’esprit
du personnage. Par moment, je cherche un effet humoristique de ce genre
en collant deux silhouettes côte à côte dans Alan,
mais je veux que ça reste vivant. J’admire la faculté
singulière de Will Eisner à brasser les générations.
Evidemment, son noir et blanc m’a beaucoup marqué quand j’étais
petit, et ça revient forcément d’une façon
ou d’une autre. Quant au burlesque, qui était une référence
déclarée  dans
La Fille du professeur, il m’a appris à poser ma
caméra au bon endroit et fixer des personnages qui gigotent devant
pour décrire une action. Cela implique la présence régulière
de personnages en pieds dans mes pages, d’où la taille des
cases, parfois une case par page, permettant de voir les personnages entiers.
Mais il ne faudrait pas se méprendre sur ce réseau d’influences
américaines : j’ai un drôle de rapport avec les Etats-Unis,
où je ne suis jamais allé ! C’est un pays qui
m’est proche pour toutes sortes de raisons, dont la plus cuisante
est bien sûr la personnalité d’Alan. Même si
Alan était un vieil Américain très atypique, puisqu’il
n’a jamais voulu remettre les pieds dans son pays depuis 1947 et
qu’il s’était européanisé.
dans
La Fille du professeur, il m’a appris à poser ma
caméra au bon endroit et fixer des personnages qui gigotent devant
pour décrire une action. Cela implique la présence régulière
de personnages en pieds dans mes pages, d’où la taille des
cases, parfois une case par page, permettant de voir les personnages entiers.
Mais il ne faudrait pas se méprendre sur ce réseau d’influences
américaines : j’ai un drôle de rapport avec les Etats-Unis,
où je ne suis jamais allé ! C’est un pays qui
m’est proche pour toutes sortes de raisons, dont la plus cuisante
est bien sûr la personnalité d’Alan. Même si
Alan était un vieil Américain très atypique, puisqu’il
n’a jamais voulu remettre les pieds dans son pays depuis 1947 et
qu’il s’était européanisé.
Dans Le Capitaine écarlate, les références
sont davantage à chercher du côté de Félix
Vallotton.
 Oui,
en effet. Et pourtant, la technique est la même : à
part la couleur, c’est le même type de lavis, utilisé
pareil : de l’encre et de l’eau, au pinceau. Selon une
technique trouvée par hasard, dans mes carnets de croquis, en observant
la façon dont l’encre diffuse dans l’eau, comment on
peut la mettre en culture dans des petits pots. Cela m’a permis
d’obtenir ce grain qui me tenait vraiment à cœur, ou
ces traits inconstants, parfois bouffés aux mites… Je n’ai
pas d’autre justification à cela que le plaisir de mon œil
et, effectivement, l’allusion avouée à une époque,
à un certain type de gravure…
Oui,
en effet. Et pourtant, la technique est la même : à
part la couleur, c’est le même type de lavis, utilisé
pareil : de l’encre et de l’eau, au pinceau. Selon une
technique trouvée par hasard, dans mes carnets de croquis, en observant
la façon dont l’encre diffuse dans l’eau, comment on
peut la mettre en culture dans des petits pots. Cela m’a permis
d’obtenir ce grain qui me tenait vraiment à cœur, ou
ces traits inconstants, parfois bouffés aux mites… Je n’ai
pas d’autre justification à cela que le plaisir de mon œil
et, effectivement, l’allusion avouée à une époque,
à un certain type de gravure…

Mais j’aime bien aussi changer de technique, parfois au cours d’un même album. De l’enfance, quelques dizaines de pages sont déjà dessinées (certaine sont parues dans Lapin) selon la même technique que la guerre. Comme il faut que le lecteur oublie le dessin, je ne peux pas le bousculer avec des ruptures esthétiques : il y a donc de fortes chances pour que je recommence ce que j’ai fait jusqu’ici et que toute l’enfance soit dessinée autrement que la guerre. Grosso modo, je vais terminer La Guerre d’Alan comme je l’ai commencée, en ne me refusant pas quelques menus changements. Surtout, je me détends en restant longtemps sans utiliser cette technique. Sur Sardine je travaille donc au stylo, sur le livre que je prépare avec mon copain photographe ce sera tout à fait autre chose… Donc quand je me remettrai à Alan je serai suffisamment frais pour retrouver ma petite chimie d’encres et d’eau.
 La
constance du style est une question qui me taraude. J’ai placé
Les Olives noires dans une certaine perspective, qui répondait
à l’impression que me faisaient les premières pages
que m’avait écrites Joann. Lequel n’écrit jamais
plus de cinq pages d’affilée, si bien qu’on ne sait
jamais où on va. La première scène, un père
et son fils dans le désert, est très intimiste, très
tendre. Croyant y voir la tonalité de la série, j’ai
décidé d’être plus réaliste que dans
La Fille du professeur, pour être plus de plain-pied avec
les personnages, tout en restant assez simple. Je me suis obligé
à une exigence anatomique, un réalisme qui commence à
me peser un peu, à mesure qu’on avance dans ce récit
qui se fait plus chaotique, plus cru, plus âpre, parfois plus grimaçant.
Peut-on changer de dessin au cours d’une série ? Ce
ne sera pas le cas du troisième album, qui reste dans le même
tonalité, mais peut-être le suivant sera-t-il différent.
Si on veut tenir longtemps, il me faudra louvoyer comme j’en ai
l’habitude, pour éviter la « sclérose en
cases ». De son côté, Joann a voulu sortir du
découpage en « gaufrier » avec lequel il
a commencé la série, mais je n’ai pas voulu. Je n’ai
pas eu envie de dessiner des « cases de bande dessinée »,
ces passages obligés dès qu’on commence à « découper »
beaucoup.
La
constance du style est une question qui me taraude. J’ai placé
Les Olives noires dans une certaine perspective, qui répondait
à l’impression que me faisaient les premières pages
que m’avait écrites Joann. Lequel n’écrit jamais
plus de cinq pages d’affilée, si bien qu’on ne sait
jamais où on va. La première scène, un père
et son fils dans le désert, est très intimiste, très
tendre. Croyant y voir la tonalité de la série, j’ai
décidé d’être plus réaliste que dans
La Fille du professeur, pour être plus de plain-pied avec
les personnages, tout en restant assez simple. Je me suis obligé
à une exigence anatomique, un réalisme qui commence à
me peser un peu, à mesure qu’on avance dans ce récit
qui se fait plus chaotique, plus cru, plus âpre, parfois plus grimaçant.
Peut-on changer de dessin au cours d’une série ? Ce
ne sera pas le cas du troisième album, qui reste dans le même
tonalité, mais peut-être le suivant sera-t-il différent.
Si on veut tenir longtemps, il me faudra louvoyer comme j’en ai
l’habitude, pour éviter la « sclérose en
cases ». De son côté, Joann a voulu sortir du
découpage en « gaufrier » avec lequel il
a commencé la série, mais je n’ai pas voulu. Je n’ai
pas eu envie de dessiner des « cases de bande dessinée »,
ces passages obligés dès qu’on commence à « découper »
beaucoup. 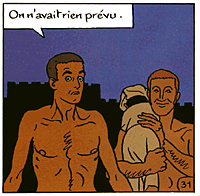 J’aime
bien cette contrainte de l’« écran »,
ces cases de dimensions constantes, parce que ça oblige à
trouver des solutions très subtiles. Quand je lis la séquence
du désert dans le scénario de Joann, je me rends compte
que j’ai à dessiner un nombre infini de cases où il
ne se passe rien : une discussion entre deux personnages dans un désert,
de nuit ! Si j’avais la ressource de cases de dimensions différentes,
je l’utiliserais à fond pour me donner à moi-même
l’impression que je diversifie les choses, que je les enrichit,
que je les enlumine. Moi, j’aime mieux avoir à m’en
sortir avec des cases rigoureusement de mêmes dimensions, qui m’évitent
de tomber dans ce que je considérerais, pour ce récit, comme
un travers, et m’obligent à trouver des solutions de cadrage,
où un simple basculement par rapport à l’horizon va
dire quelque chose.
J’aime
bien cette contrainte de l’« écran »,
ces cases de dimensions constantes, parce que ça oblige à
trouver des solutions très subtiles. Quand je lis la séquence
du désert dans le scénario de Joann, je me rends compte
que j’ai à dessiner un nombre infini de cases où il
ne se passe rien : une discussion entre deux personnages dans un désert,
de nuit ! Si j’avais la ressource de cases de dimensions différentes,
je l’utiliserais à fond pour me donner à moi-même
l’impression que je diversifie les choses, que je les enrichit,
que je les enlumine. Moi, j’aime mieux avoir à m’en
sortir avec des cases rigoureusement de mêmes dimensions, qui m’évitent
de tomber dans ce que je considérerais, pour ce récit, comme
un travers, et m’obligent à trouver des solutions de cadrage,
où un simple basculement par rapport à l’horizon va
dire quelque chose.

Pour cette série, vous avez confié les couleurs
à Walter.
Quand on s’est lancé dans Les Olives, ça
m’embêtait de ne pas faire ces premières pages en couleurs,
tant je voyais ce crépuscule sur le désert, cet enfant qui
joue avec les sauterelles… Je n’avais qu’une envie,
c’est de sortir ma boîte d’aquarelles. C’est Joann
qui m’en a empêché, en me disant que j’allais
y passer ma vie. Il m’a dit « Pense qu’on fait
de la série Z. On fait des livres où on met tout ce qu’on
peut, toute notre vie, mais on ne peut pas passer cent-sept ans sur chacun
d’entre eux. » Or j’ai cette capacité
de tomber dans mes propres images, à m’appesantir sur un
truc parce que ça me plaît. Je parviens non pas à
renoncer à ce plaisir (puisque je me l’offre volontiers dans
mes croquis), mais à l’aménager pour pouvoir faire
mes livres rapidement. Cette année, il y aura quand même
trois Sardine, deux Ariol, deux Olives et un
Alan !
Je laisse une entière liberté à Walter. Pour le premier
tome, il a fallu mettre les choses en route tous les deux : comme
il fait des couleurs pour Joann, pour Totof, pour Lewis, il y a forcément
un peu carambolage lorsqu’il sort du dessin de l’un pour passer
à celui d’un autre. Il était encore à Paris,
donc nous avons travaillé ensemble chez lui. Puis il est parti
vivre à Tokyo. Il m’a envoyé des planches qui me convenaient
parfaitement et je n’ai plus rien à lui dire. La règle
d’or à laquelle nous sommes arrivés entre amis collaborateurs,
c’est qu’on se fiche la paix ! Si on commence à déraper,
si l’un des deux lâche la bride, on se le dit. Mais si on
se surprend, on se laisse aller et on voit ce que ça donne. Il
ne faut pas risquer de se censurer ou de se restreindre.
L’atelier
Parlons d’un fameux groupe d’amis : qu’est-ce
qui vous a amené à l’atelier Nawak ?
En 1994, je travaillais encore chez moi sur des bandes dessinées
de commande pour Bayard, des adaptations littéraires, des choses
comme ça, qui ne sont jamais sorties en albums. Je voulais évoluer,
changer... Et j’ai rencontré David B. qui m’a parlé
de l’atelier, de l’Association. Je connaissais vaguement ces
noms que Berberian m’avait déjà cités lorsque
je l’avais croisé deux ans auparavant dans un festival, mais
je n’étais jamais allé voir ! A l’invitation
de David, je suis allé rencontrer ces gens à l’atelier,
rue Quincampoix, où travaillaient côte à côte
Joann [Sfar], Totof [Christophe Blain], Emile Bravo, David, Frédéric
Boilet, Fabrice Tarin, Hélène Nicoux et Tronchet. Lewis
[Trondheim] et Jean-Yves Duhoo venaient de partir : j’ai demandé
si je pouvais en être dès que quelqu’un s’en
irait. J’ai commencé à faire connaissance avec eux.
La première fois, j’ai apporté mes carnets, qui m’ont
attiré la sympathie de Totof et de Joann. Du jour au lendemain
j’avais une bande de copains. C’était un rêve.
En même temps, j’avais un peu peur : ayant l’habitude
de travailler seul, comment allais-je vivre dans cette ambiance où
tout le monde gueule, où ça rentre, ça sort, où
il faut toujours décrocher le téléphone… D’autres
sont restés quinze jours et sont repartis effrayés !
Mais j’ai réussi à travailler dans cet environnement,
parce que je l’ai voulu. On s’est bien marré, on allait
ensemble au cinéma, en vacances… on est devenu comme les
doigts de la main.
C’est curieux, il y avait jusqu’alors deux choses auxquelles
je refusais de croire : les maîtres à penser et les générations.
Je lisais des livres sur les surréalistes, sur Gide…, ces
gens qui allaient sonner à la porte de leurs aînés
ou d’autres auteurs, qui se rassemblaient dans des groupes…
et je me disais que ça ne ressemblait pas à la vie moderne,
que tout ça était fini. Soudain, le même année,
j’ai rencontré Alan – qui, sans être un maître
à penser, a marqué mon existence – et les copains
de l’atelier et de l’Asso, avec qui j’ai senti une communion
générationnelle. Mes convictions ont été battues
en brèche !
A quoi travailliez-vous alors ?
Depuis Brune, que des boulots alimentaires : illustrations, jeux
pour enfants, couvertures de livres… J’ai arrêté
l’illustration dès que j’ai pu, parce que je n’aime
pas ça et j’ai décidé de me mettre en position
de ne faire que de la bande dessinée et des croquis, pour être
heureux.
Qu’est-ce qui pousse alors Joann à vous confier le
dessin de La Fille du professeur ?
 On
a mis longtemps : c’est au bout de six ou huit mois qu’on
s’est dit qu’on pourrait travailler ensemble. A l’origine,
l’atelier n’était pas fait pour que les gens collaborent,
mais pour qu’ils aient un lieu de travail commun, de l’espace
pour ceux qui n’en avaient pas assez chez eux… Mais on est
dans une classe sans professeur, où chacun regarde ce que font
les autres ; il serait étrange que l’on n’ait pas envie
à un moment ou à un autre d’essayer des trucs, de
travailler ensemble… Beaucoup de configurations ont été
essayées : Lewis/Joann, David/Joann, David/Totof, Totof/Joann,
moi/Joann, moi/David… Même sans collaborer vraiment : on a
tous consulté Emile pour un certain nombre de choses… ;
j’ai même fait des couleurs pour Lewis, ou pour une page du
Petrus Barbygère de Joann ! Ce dernier, quand il
est parti vivre quelque temps en Thaïlande, nous a dit qu’il
penserait à chacun de nous en faisant un album, parce qu’il
faisait régulièrement appel au savoir-faire de Totof pour
résoudre un problème dans une scène d’action,
à celui d’Emile pour rendre une séquence plus drôle,
ou au mien pour une question de lisibilité…
On
a mis longtemps : c’est au bout de six ou huit mois qu’on
s’est dit qu’on pourrait travailler ensemble. A l’origine,
l’atelier n’était pas fait pour que les gens collaborent,
mais pour qu’ils aient un lieu de travail commun, de l’espace
pour ceux qui n’en avaient pas assez chez eux… Mais on est
dans une classe sans professeur, où chacun regarde ce que font
les autres ; il serait étrange que l’on n’ait pas envie
à un moment ou à un autre d’essayer des trucs, de
travailler ensemble… Beaucoup de configurations ont été
essayées : Lewis/Joann, David/Joann, David/Totof, Totof/Joann,
moi/Joann, moi/David… Même sans collaborer vraiment : on a
tous consulté Emile pour un certain nombre de choses… ;
j’ai même fait des couleurs pour Lewis, ou pour une page du
Petrus Barbygère de Joann ! Ce dernier, quand il
est parti vivre quelque temps en Thaïlande, nous a dit qu’il
penserait à chacun de nous en faisant un album, parce qu’il
faisait régulièrement appel au savoir-faire de Totof pour
résoudre un problème dans une scène d’action,
à celui d’Emile pour rendre une séquence plus drôle,
ou au mien pour une question de lisibilité…
J’ai quitté l’atelier pour des raisons personnelles :
Alan étant malade, j’allais passer dix jours par mois chez
lui ; j’en revenais vanné et je travaillais chez moi.
Bref je n’y allais plus…
Alan, encore et toujours
Comment l’idée de faire une bande dessinée
de la vie d’Alan s’est-elle concrétisée ?
J’ai rencontré Alan et l’Asso au même moment.
J’ai très vite dit à Alan qu’on allait faire
un livre. Connaissant Lapin, j’ai rencontré Menu
dans un café et je lui en ai parlé. Menu m’a dit « C’est
intéressant. » Alan recevait Lapin, qu’il
me commentait dans ses lettres, me parlant de Mattt Konture, de Joann…
il se reconnaissait là-dedans.
Je trouve que la bande dessinée est un mode d’expression
qui convient parfaitement à la biographie. Je suis un lecteur émerveillé
des biographies de Jijé. Il y a une incursion de l’adulte
dans ses histoires comme il n’y en a dans aucune bande dessinée
pour la jeunesse, et c’est en grande partie dû à leur
nature biographique. La série qu’entreprend Marjane Satrapi
dans Persepolis est remarquable. Comme elle, d’ailleurs,
je reçois de nombreuses réactions de lecteurs : c’est
le genre de livres qui éveillent chez les gens un besoin de parler,
parfois d’eux-mêmes. J’ai même maintenant un merveilleux
copain de 67 ans, qui habite dans le sud de l’Angleterre :
il a acheté La Guerre d’Alan à Paris, l’a
lu dans l’Eurostar et m’a écrit en arrivant à
Waterloo Station une lettre émue. Depuis, j’ai tous les quinze
jours une lettre de lui dans ma boîte à lettres…
Est-ce parce que vous connaissiez l’Association que vous
avez pensé possible d’en faire un livre ?
Il y avait quand même des précédents, comme Maus,
qui m’a fortement marqué. Je l’aurais donc fait de
toute façon, mais il n’aurait pas eu la même forme,
parce que j’aurais sans doute cherché à le formater
pour le proposer à des éditeurs traditionnels. Je me serais
senti moins libre…
Lorsque j’achève un Alan, je suis épuisé
tout en ressentant la nécessité impérieuse de continuer.
Il faudrait aller jusqu’au bout pratiquement d’une traite.
Mais ce serait risqué… S’interrompre, ce pourrait aussi
risquer de perdre de vue la raison de le faire… Pourtant, il suffit
que je remette le magnétophone en marche et que j’entende
la voix d’Alan pour qu’il me redise « Vas-y
! » Paradoxalement, la guerre, par où j’ai
commencé son récit, est ce qu’il y a de plus extérieur,
de plus anecdotique… Que les gens se soient senti proches de ce
qu’il y raconte m’encourage, parce que le récit de
son enfance est encore plus poignant et plus vrai que ce que je ferai
jamais avec la période de la guerre. J’aurais d’ailleurs
voulu commencer par l’enfance, mais sa maladie en a voulu autrement.
Je ne le regrette pas : après avoir pris connaissance des
trois tomes de La Guerre d’Alan, le lecteur sera encore
plus touché de découvrir ce par quoi est passé le
petit garçon des trois tomes de L’enfance d’Alan.
Puis viendra un dernier tome intitulé Alan, sur nous deux,
que j’écrirai, mais je ne sais pas quand : parfois je
sens que c’est pressant, parfois non. Je suis soucieux de perdre
le moins de souvenirs possibles et en même temps j’aime bien
ce que la mémoire fait à mon souvenir d’Alan. Et je
pense que c’était bien de ne pas le faire maintenant, parce
que la maladie d’Alan – un an et demi d’un cancer redoutable
– a pris le pas sur le reste dans mes souvenirs. J’attends
donc que les choses s’équilibrent dans ma mémoire.
L’enseignement que j’ai tiré de l’épisode
Brune, d’où je suis sorti laminé après
six années de labeur, c’est que je peux compter sur une chose :
ma force de travail, mon opiniâtreté, mon désir d’aller
au bout. A l’orée du boulot sur Alan, je me suis
dit que la tâche était gigantesque, mais que j’arriverais
au bout. On a besoin de rouler un peu les mécaniques avant de se
lancer dans un boulot, en se disant « Je peux le faire. »
Je suis d’ailleurs sensible, dans l’œuvre des autres,
à un certain trop-plein de solitude que je décèle
parfois à la lecture de certains travaux de gens que j’aime
et dont je sens qu’ils se sont fourvoyés, ou amoindris, ou
aigris parce qu’il leur a manqué l’interlocuteur qu’il
fallait au moment voulu. Quelqu’un à qui parler, quelqu’un
qui bouscule vos inhibitions, qui vous cherche et à qui vous rendez
la pareille : un ami. Cela s’assortit d’une chose indispensable
à l’amitié : une certaine dose d’admiration.
Ce projet de longue haleine sera-t-il interrompu par d’autres
ouvrages ?
Il faudrait aussi que je pense à faire quelque chose pour ma fille.
Je commence sérieusement à y penser. Je suis content de
remplir petit à petit sa bibliothèque avec Sardine
et Ariol… Je voudrais faire des vrais livres pour enfants,
mais je ne suis pas encore sorti du mécanisme d’infantilisation
que j’évoquais : j’ai encore des phares plantés
devant ce rivage, qui m’empêchent encore d’y accoster.
J’admire Sempé, par exemple, Marcellin Caillou, L’ascension
de Monsieur Lambert..., tous sont de grands livres. Du coup, je commence
à écrire des livres pour enfants, puis ils se complexifient
à mesure que je les écris. Il se remplissent, plutôt ;
ils sortent du format de livre pour enfants et deviennent des bandes dessinées.
Il faudrait pousser cela jusqu’au bout pour ensuite en tirer le
suc, un précipité intéressant. Je n’ai pas
encore réussi à me lancer là-dedans.
J’aimerais aussi beaucoup que la publication de mes carnets de croquis
se poursuive, car cela me permet de montrer une partie de mon travail
qui n’a pas grand chose à voir avec la bande dessinée
et qui me permet de dire des choses que je ne dis pas par ailleurs. Mais
je ne veux pas en faire des livres coûteux réservés
aux amateurs. Je veux qu’on puisse les trouver dans les maisons
de la presse. Pour cela, avec Frédéric, on fait une mise
en page au cordeau, assez rigoureuse...
Mais il y a surtout ce projet avec mon copain photographe, qui mériterait
au bas mot autant de volumes, ce que je ne pourrai pas faire. Nous allons
donc raconter ensemble une mission, mais on va essayer de le faire très
vite. Et après, on verra.
 Propos
recueillis par Gilles Ciment
Propos
recueillis par Gilles Ciment
à Paris le 8 mai 2002
Entretien paru
dans
9ème
Art
n° 8
janvier 2003
| Compléments |
Lire
mon texte sur les travaux d'Emmanuel Guibert jusqu'en 2000 |